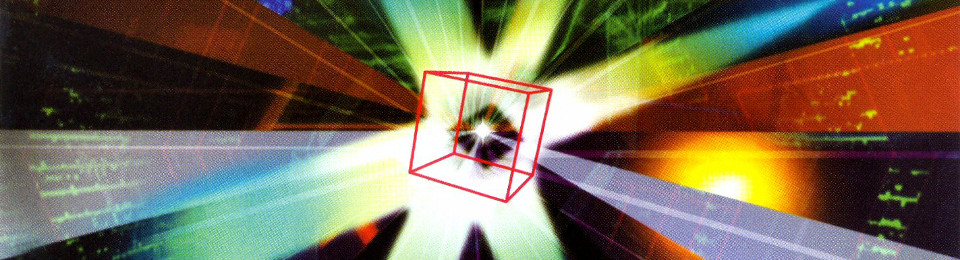Le 21 octobre 2016 est sorti Civilization VI, un jeu de stratégie et de gestion excellent, aux boucles de gameplay bien pensées et addictives. Ce billet n’a pas pour objet de réfléchir aux conditions du succès de cette expérience vidéoludique, ni de la décrire. J’aimerais plutôt aborder, sans le juger, le substrat culturel qui nourrit la représentation de l’humanité dans la série Civilization. La multiplication des factions et des personnages historiques côtoie en effet un gameplay commun à tous, directement inspiré par une vision européenne de la civilisation, dont il est intéressant d’identifier les grands motifs. La représentation du monde portée par Civilization, profondément européenne, est d’autant plus facile à élever en modèle commun à toute l’humanité que ce processus existe et a existé dans le réel. À partir de la première mondialisation des XVIe et XVIIe siècles, l’homogénéisation des imaginaires humains s’est faite au rythme et à l’image des empires les plus puissants, tous issus de la matrice européenne. Depuis l’Espagne sur laquelle le soleil ne se couche jamais jusqu’à l’empire des États-Unis, la pensée issue de la matrice européenne s’est posée en référent de tous les imaginaires humains, venant les métisser et les infléchir plus que les remplacer.
Civilization est l’héritier de ce processus d’élévation de l’imaginaire européen à l’état d’imaginaire humain. Tout comme les humains de Star Trek parlent l’English et ont adopté le code moral et la sensibilité des gentlemen anglais, Civilization propose une vision unifiée de l’humanité teintée par son origine américaine. Car, si l’on réduit la signification de son expérience de jeu à sa substantifique moëlle, on voit que Civilization propose au joueur d’exploiter un environnement stable et abondant afin de progresser vers une mondialisation heureuse tout en disputant l’hégémonie à ses voisins.
Un environnement abondant et éternel
L’environnement de Civilization est un biome rêvé. Les ressources y sont facilement accessibles et leurs filons sont intarissables ; l’enjeu pour les joueurs est donc moins de gérer intelligemment ces ressources que de les préempter le plus vite possible et d’en exploiter un maximum. Si les ressources stratégiques sont limitées, dans le sens où elles ne peuvent satisfaire qu’un nombre limité d’unités (par exemple, une unité de chevaux ne peut être allouée qu’à une unité de cavalerie), elle ne s’épuisent toutefois jamais, sont stables et ne connaissent ni le lessivage, ni l’effondrement, ni la baisse de rendement. L’espace naturel, dans son ensemble, est un espace à conquérir et l’industrialisation n’a aucun effet négatif sur le milieu. La pollution est absente, les dysfonctionnements climatiques n’existent pas, la désertification n’inquiète personne. La nature présentée par Civilization est bien plus celle que les Européens libéraux croyaient (croient toujours ?) pouvoir dominer que ce système fragile, fait d’équilibres multiples et entré en crise, dans lequel nous vivons.
Cet imaginaire d’une nature abondante à exploiter jusqu’à la moëlle est profondément ancré dans la culture européenne et y devient hégémonique au XVIe siècle. Elle trouve sa légitimité, aux yeux des hommes de l’époque, dans la Genèse 1.26 : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ». Puisque la nature a été créée pour les plaisirs humains, alors la question n’est pas de gérer intelligemment la finitude de la biodiversité (pour éviter qu’elle ne s’épuise), mais de l’exploiter le plus massivement possible. Cette vision chrétienne de la nature a accompagné le développement du capitalisme européen dans ses diverses phases, depuis le XIIe siècle, et a empêché à cette culture de penser l’effondrement environnemental.
Il aurait pu ne pas en être ainsi. L’histoire étant faite de contingences, on remarque que, jusqu’au XVe siècle, un second paradigme chrétien de la nature cohabitait avec celui de la Genèse. Dans le premier épître aux Romains, Saint Paul dit : « La créature elle-même sera libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu ». Cette phrase a laissé perplexes un grand nombre de théologiens médiévaux et a alimenté leurs débats. Si les cochons, les vaches, les fourmis et les autres animaux peuvent entrer au paradis et siéger à la droite de Dieu, béats de sa lumière, cela ne signifie-t-il pas qu’ils sont dôtés d’une âme ? Mais alors, s’ils possèdent une âme, faut-il baptiser les animaux ? Sont-ils responsables de leurs actes ? Et qu’en est-il des animaux sataniques, alliés de l’Ennemi, comme le dragon ? Le dragon peut-il être sauvé ? Force est de constater qu’à la fin du Moyen Âge, l’idée selon laquelle les animaux sont responsables de leurs actes et pouvaient gagner leur place au paradis était relativement ancrée dans les esprits : certains juges les traduisaient en justice tandis que de nombreux Saints préchaient la bonne parole aux bêtes (à l’image de Saint François d’Assise édifiant les oiseaux). On trouve également des évèques savoyards se résolvant à excommunier la société des rats, après l’échec de pourparlers avec leur souverain (qui n’a même pas daigné se présenter). Cette lecture de Saint Paul était porteuse d’une relation différente à la nature que celle de la Genèse, mais était développée par une minorité d’auteurs médiévaux. L’environnement était alors certes perçu comme une création, mais une création respectable où l’humain possède une place parmi d’autres et doit composer avec les autres habitants légitimes de la sphère terrestre. La première mondialisation du XVIe siècle et l’exploitation systématique des Amériques enterra toutefois définitivement cette seconde voie.
Civilization ne fait pas le choix de cette matrice minoritaire et lui préfère la majoritaire qui sous-tend nos esprits productivistes. Cette nature imaginée comme éternelle et stable permet aux sociétés de tendre vers un progrès linéaire, uniforme et mondialisé.
Du progrès linéaire à la mondialisation heureuse
Bien qu’ils aient fait un effort de complexification avec Civilization VI, les arbres technologiques de ces jeux vidéo, représentant les savoirs acquis par une société, restent extrêmement linéaires. Il n’est pas possible d’atteindre l’administration sans être passé par la roue. Une représentation bien réductrice des capacités d’invention humaines, mais, surtout, encore une fois directement issue de la pensée européenne. Au XIXe siècle, alors que les ethnographes commencent à arpenter les cultures qu’ils jugent« primitives », un historien français, Guizot, propose un schéma explicatif de l’évolution technique humaine. Pour Guizot, le progrès est linéaire et ne connaît qu’une possibilité d’évolution. Les sociétés humaines commencent à l’état de tribus, puis se développent en créant des villages, des villes, des infrastructures, et, enfin, l’État bourgeois européen, pinacle de la civilisation. Guizot envisageait bien qu’il existât d’autres formes plus abouties d’organisation sociale, mais elles tendraient nécessairement à l’amélioration de la condition humaine, dans un modèle résolument optimiste. Le schéma de Guizot, grand professeur de la Sorbonne, fut partagé et repris par la plupart des universités européennes et s’enkysta durablement dans nos esprits. Encore aujourd’hui, le musée du Quai Branly parle de « cultures premières » et d’« arts premiers », alors que les cultures traditionnelles africaines, océaniennes ou amazoniennes ne se sont pas figées à un état primitif. Elles ont adopté des formes en renouvellement constant et adaptées à leurs conditions de vie.
Civilization adopte clairement le schéma de Guizot : non seulement les technologies sont linéaires, de celles jugées les plus « simples » aux plus « complexes » (en oubliant que, par exemple, les sociétés amérindiennes ont inventé l’administration sans avoir inventé la roue…), mais encore, à partir de l’ère industrielle, les villes s’uniformisent sur le modèle européen. Car Civilization voit plus loin que Guizot et intègre les idées de la « mondialisation heureuse » et de la « fin de l’histoire », deux concepts datant des années 1980 et 1990. La mondialisation heureuse pose la prémisse non démontrée que l’augmentation des échanges mondiaux libéralisés et des interconnexions améliorera mécaniquement les conditions de vie de tous les humains connectés. Tandis que la fin de l’histoire prêche que la chute des régimes autoritaires tendra à renforcer les démocraties et le rôle de l’Organisation des Nations Unies (ONU), jusqu’à obtenir une société mondiale, démocratique, heureuse et coopérative, appuyée sur les idéaux libéraux. L’histoire prendra alors fin, car les conflits seront tous gérés au sein de l’ONU, sans besoin de guerre. Ces deux idéologies sont désormais globalement abandonnées, puisque l’histoire a récemment prouvé leur vacuité.
Toutefois, elles sous-tendent clairement tout le gameplay non-belliciste de Civilization. La victoire diplomatique consistant à former un congrès mondial suffisamment mûr pour se doter d’un chef renvoie à la « fin de l’histoire » (c’est d’ailleurs la fin de l’histoire du joueur). La victoire technologique suppose que le progrès ne s’arrêtera jamais de progresser de manière linéaire, jusqu’à ce que les humains soient capables de coloniser l’espace. La victoire culturelle est une représentation, par le gameplay, de l’uniformisation des cultures sous la pression de la mondialisation et des industries culturelles calquées sur celle des Etats-Unis. Laquelle véhicule l’idée que, lorsque chaque peuple aura été américanisé, la paix viendra de l’unification des mœurs (!). Toutes ces conditions de victoire semblent avoir été dérivées du corpus idéologique européen contemporain, et, même, plus précisément, du corpus états-unien, car la théorie de la fin de l’histoire n’a jamais vraiment pénétré la culture européenne, les intellectuels européens la jugeant trop manichéenne. Elles portent des représentations positives de l’humanité (dont on suppose qu’elle puisse sans cesse s’améliorer et trouver une paix mondiale), mais des représentations, à vrai dire, profondément impérialistes. Le constat de la réussite des empires européens, qui ont conquis cinq sixièmes du globe et ont, ensuite, remodelé les cultures à leur image, pousse Civilization à en adopter le corpus idéologique dans son entièreté et à en dériver des lignes de gameplay. Or, cet impérialisme occidental n’a pas été un pique-nique joyeux. Depuis l’extermination des Amérindiens par les Espagnols jusqu’au pilonnage par les Américains des ports japonais pour les forcer à adopter le libre-échange, les empires mondialisés se sont d’abord construits grâce à la violence et aux armes.
Course aux armements et impérialisme militaire
L’armement des nations joue un rôle important dans toute partie de Civilization : une course aux armements multilatérale s’opère pour éviter de se faire envahir, ou, au contraire, menacer les autres joueurs. Cette course contraint à améliorer la technologie de ses unités en permanence, afin de ne pas être laissé en arrière. De prime abord, on pourrait croire que c’est là une réalité historique positive ; après tout, la première guerre mondiale, la seconde et la Guerre froide n’ont-elles pas montré que le monde entier pouvait rentrer dans une spirale de course aux armements ? Ce serait voir l’histoire non seulement sur le très court terme (un siècle) et d’une manière trop schématique. S’il est vrai que la course aux armements est désormais pratiquée par toute nation moderne, il n’en a pas toujours été ainsi et, surtout, on peut dater très précisément la naissance de ce climat militariste.
La course aux armements et la paranoïa militariste trouvent leur source dans deux guerres endémiques européennes médiévales. D’une part la Reconquista, croisade permanente des ibériques chrétiens contre les royaumes musulmans implantés dans la péninsule depuis le VIIIe siècle, d’autre part la guerre dite de Cent Ans, mettant aux prises les différentes composantes du royaume de France et le royaume d’Angleterre. Ces deux guerres endémiques ont accouché de sociétés qui n’étaient plus seulement portées à la guerre, mais structurées par elle, jusqu’à modeler les manières de penser et de se comporter des habitants. Prenons le cas des Français (habitants de l’île-de-France) du XVe siècle, empêtrés dans des guerres civiles sans fin (1400-1407 ; 1411-1435 ; 1445 ; 1468-1477…). Il est frappant de voir que tout bon voyageur français de cette époque, arpentant des pays étrangers, n’est ni touché par les paysages, ni par les coutumes locales, encore moins par les arts ou la nourriture du terroir. Ce qui intéresse les Français, ce sont les capacités de défense du lieu qu’ils visitent. On les voit s’extasier devant l’épaisseur des murailles, la stature des soldats, la qualité des serpentines, l’étroitesse des cols à défendre. Les bombardes deviennent également un des cadeaux diplomatiques les plus prisés entre princes, tandis que l’idéal chevaleresque se décale insensiblement du modèle courtois du XIIe siècle vers un modèle viriliste. Geoffroy de Charny, grand chevalier du XIVe siècle, explique ainsi que piller des villages, brûler de églises et violer les femmes des voisins rapproche du salut chrétien, car c’est là ce que Dieu a décidé qu’un chevalier devait faire. Un peu plus tard, on voit les chevaliers du XVe siècle débattre de l’honneur comparé de se faire décapiter par un boulet de canon ou par une épée. Ils déplorent la mort du comte de Salisbury, en 1429, dont la tête et le casque se trouvent fusionnés par l’impact d’un boulet, lui délivrant ainsi une mort sans gloire.
Mais surtout, cette culture militariste pousse les Français, Espagnols, Anglais et Bourguignons, à sans cesse innover et chercher de nouvelles manières de réduire l’ennemi à un petit tas de chair. L’arme à feu européenne est ainsi utilisée pour la première fois par les Anglais à la bataille de Crécy (1346). Le modèle est récupéré par les autres factions, raffiné, jusqu’à donner des bombardes plus hautes qu’un homme crachant le tonnerre à chaque coup et, à l’autre bout du spectre, de petites couleuvrines portatives capables de transpercer plusieurs hommes en armure (à partir de 1420). En entrant dans d’autres régions, ces cultures rompues à la guerre totale déstabilisent des cultures pratiquant des guerres moins dures, plus ritualisées (Amériques pour les Espagnols, Italie pour les Français). Le topos des Aztèques terrorisés par les canons et les chevaux espagnols est bien connu (XVIe siècle). À cela s’ajoute le fait que les Aztèques avaient une conception rituelle de la « guerre des plumes » : toute personne tombée à terre s’avouait prisonnière. Les Espagnols, au contraire, luttaient jusqu’au dernier souffle et par tous les moyens, sans rechigner à quelque trahison. On connaît généralement moins le choc psychologique terrible subi par les Italiens lorsqu’ils ont vu déferler sur eux des Français gorgés de combativité. Les batteries de canons françaises tranchaient drastiquement avec les guerres plus ponctuelles des Italiens, entre bandes de condottieres interposées. Tranchait également la propension française à tout brûler et piller, sans discernement et sans respect des interdits chrétiens. Face à ces cultures pratiquant une guerre totale, les attaqués devaient s’adapter (Italiens) ou disparaître (Aztèques).
C’est bien par un effet de contamination et de réaction que la plupart des cultures ont dû se soumettre (colonisation) ou s’adapter (Japon, Éthiopie) à la puissance militaire développée par les cultures européennes militaristes. Le contraste est particulièrement frappant lorsqu’on analyse l’armement pratiqué au Japon. Les Japonais ont intégré par deux fois des armes à feu à leur arsenal sans juger utile de les raffiner. La bouche à feu chinoise resta utilisée sporadiquement au Japon jusqu’au XVIIe siècle, sans qu’il ne soit jugé utile de l’améliorer. Puis, avec l’introduction des armes à feu européennes par les Portugais, les daimyo japonais intégrèrent ces mousquets à leurs troupes et effectuèrent un transfert technologique (des artisans japonais apprirent leurs techniques de fabrication). Toutefois, de 1600 à 1850, encore une fois, l’art des armes à feu stagna au Japon. Ce n’est pas que les Japonais fussent incapables d’en développer de meilleures, c’est bien qu’ils n’en ressentaient pas le besoin. Dans les cultures faites de fiefs très dispersés, où l’équilibre des forces est sans cesse renégocié, par la guerre, la parole ou le mariage, l’art de la guerre n’est qu’une composante de la diplomatie parmi d’autres. Il ne s’agit pas de détruire l’adversaire, mais de l’inciter, par la violence, à se rendre à ses arguments. Dominique Barthélémy, qui a théorisé ce type de relations sociales, l’appelle le « milieu visqueux de la féodalité », car toute action suscite des réactions d’autres agents, jusqu’au retour à un équilibre de forces stable. Dans ces conditions, l’idée d’atomiser son adversaire, de le réduire en poussière, ne fait pas sens. Car l’adversaire est bien plus un partenaire diplomatique qu’un ennemi mortel. Ainsi, ce n’est que sous la pression des Britanniques et, surtout, des États-Unis, au milieu du XIXe siècle, que les Japonais furent forcés de refonder leurs rapports sociaux (ère Meïji) afin de résister à la pression et d’entrer dans une course aux armements très rapide, jusqu’à créer une armée à l’européenne et vaincre les Russes au début du XXe siècle.
De tout cela, il faut retenir l’idée que la course aux armements et la volonté de rayer toute une nation de la carte n’est en rien implantée dans la nature humaine. C’est un produit récent de notre histoire, qui naît il y a environ six cents ans en Europe et n’a achevé sa globalisation qu’au XXe siècle. Toutefois, Civilization, pour des raisons de gameplay (qui voudrait jouer à un jeu de stratégie où les unités militaires stagneraient ?), préfère essentialiser l’idée de la course aux armements et la présente comme un élément consubstantiel du genre humain.
Conclusion : l’imaginaire européen au fondement du gameplay de Civilization
Civilization a le mérite d’avoir réussi à synthétiser une matrice culturelle dans des boucles de gameplay. Voilà une ambition bien difficile à atteindre que de transformer les idéologies d’un peuple en expériences de jeu. En nous présentant des nations conquérant un environnement abondant, à couteaux tirés entre elles, mais parvenant parfois à dépasser leurs différences pour tendre vers une mondialisation heureuse, Civilization capture toutes les lignes de force de la pensée européenne du XXe siècle. Et ce jusqu’à l’essentialisation des cultures, chère aux empires coloniaux du premier XXe siècle, perçues comme ayant des caractéristiques immanentes traversant les époques (les bonus de faction). Reprocher un tel positionnement à Civilization serait quelque peu déplacé ; je le constate, et me réjouis plutôt de voir qu’il est possible de produire un bon jeu à partir de prémisses idéologiques façonnés par l’histoire.